Ibn Sina légua à l’humanité près de 450 livres, mais dont 240 seulement furent édités. Son ouvrage le plus célèbre resta «Le Livre de la Loi concernant la médecine» qui, pendant des siècles, constitua une référence principale pour les praticiens.
Ses disciples l’appelaient «Cheikh el-Raïs» car il était le prince des savants, AbuʾAli al-Husayn Ibn Abd Allah Ibn Sina, dit également Avicennes, vécut durant cette période que les historiens appelèrent l’Âge d’or islamique.
Il naquit en 980 dans un village à côté de Boukhara, dans l’Ouzbékistan actuel, où il effectua également ses études. Amoureux de voyages et épris de recherches scientifiques, il commença son parcours de praticien très tôt, proposant ses services médicaux dès l’âge de 16 ans. Arrivé à la trentaine, il eut déjà de nombreux ouvrages à son actif.
Mohamed Kamel al-Hur lui consacra un livre, «Ibn Sina, vie, parcours et philosophie», où il expliqua que «la deuxième phase de la vie de ce savant fut celle de la production scientifique». En effet, il commença l’écriture à 21 ans. «Il n’aurait pas été facile pour un autre jeune homme de se consacrer à l’écriture avec autant d’assiduité, dans une période qui fut également celle des conflits, des dissidences politiques et des guerres des courants religieux», précisa le chercheur.
En plus des sciences médicales et naturelle, Ibn Sina s’intéressait au droit, aux mathématiques, à l’arithmétique, à l’algèbre et à la géométrie, entre autres. Il fit ses premières armes aurpès de professeurs de renoms, tels q’Abu Mansur al-Hasan ibn Nuh al-Qumri, qui était médecin à la cour princière, ou encote Abu Sahl Isa ibn Yahya al-Masihi al-Jurjani, auteur d’un traité de la médecine.
Ibn Sina avait aussi la fibre artistiques, cultivant un intérêt particulier pour la musique, la littérature et la poésie. Par ailleurs, il fut un théologien éclairé et contribua à réintégrer le dogme dans son élaboration philosophique, défendant même que la métaphysique devait prouver l’existence divine. En tant que philosophie, il commenta l’œuvre d’Aristote en s’aidant des explications d’al-Farabi.
Mais son ouvrage le plus célèbre demeura le «Livre de la Loi concernant la médecine» et pendant des siècles, il fut la référence principale des praticiens et des chercheurs. Mahmoud Abbas Akkad indiqua que cette œuvre «fut un pilier des sciences médicales qu’enseigna Ibn Sina à ses disciples, basées sur ses expériences et ses traitements». Cependant, un importante partie en fut perdue «entre les raids des armées et les fuites auxquelles il fut contraint».
Un texte fondateur des sciences médicales modernes
Ce qui avait été sauvé de cet ouvrage encyclopédique de médecine médiévale, rédigé en arabe et achevé vers 1020, fut conservé dans le plus ancien exemplaire connu, également rédigé en langue arabe et daté de 1052. Il servit d’ouvrage base de l’enseignement des sciences médicales en Europe jusqu’au XVIIe siècle.
Traduit en latin par Gérard de Crémone (1150 et 1187) sous le titre Canon medicinae puis au début du XVIe siècle par Andrea Alpago, cet ouvrage fut aussi l’un des premiers à être imprimés en arabe, en 1593, à Rome. Une partie de son contenue ne fut remise en question que plus tard avec Léonard de Vinci, notamment concernant l’anatomie telle qu’Ibn Sina l’avait représentée.
Ce ne fut qu’en 1628, lorsque le médecin anglais William Harvey découvrit la petite et la grande circulation sanguine, que des enseignements du «Livre de la Loi concernant la médecine» furent classés comme relevant de la science ancienne.
Par ailleurs, Ibn Sina eut le grand mérite d’avoir décrit en détail les premiers symptômes de la méningite. Plus globalement, il mit l’accent sur l’apport de la psychothérapie dans le processus de convalescence. «Parmi les exploits qui lui revinrent, il diagnostiqua les calculs urinaires avec beaucoup de précision, les différenciant même des calculs rénaux et décrivit de manière inédite les méningites en distinguant entre leurs variétés», nota l’édition 149 du magazine «Daawat Alhaq».
Selon la même source, «il fut parmi les médecins ayant décrit le plus fidèlement la pleurésie, en prouvant que cette maladie devait être distinguée de l’abcès du foie, de la pneumonie et des bronchites». Il donna aussi «des explications scientifiques plausibles à la jaunisse, aux accidents vasculaires cérébraux (AVC) et à la congestion sanguine». Grâce à lui, «la méthode de refroidissement pour arrêter les saignements fut plus largement utilisée»

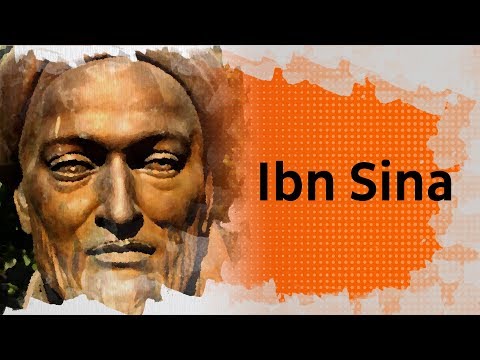




Commentaire