Je vous conseille ce livre, chronique d'un observateur en Irak, qui de favorable à l'intervention est devenu plus que sceptique. Ce qui prime dans le microcosme ce n'est pas la haute stratégie mais l'incompétence, le rêve, la médiocrité aussi.
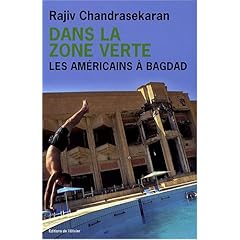
.
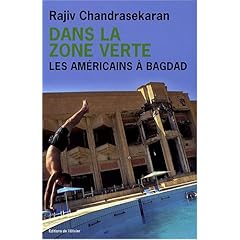
Présentation de l'éditeur
Envoyé spécial à Bagdad, Rajiv Chandrasekaran a enquêté pendant un an et demi dans la Zone verte, cette " petite Amérique" recréée par l'administration Bush pour accueillir les spécialistes chargés de faire de l'Irak une démocratie moderne. Le journaliste décrit le quotidien de ces Américains vivant en plein centre d'un pays dévasté par les bombardements et en proie à l'anarchie.
C'est l'histoire, racontée de l'intérieur, d'une organisation qui s'obstine jusqu'à l'absurde à mettre en place des projets en décalage complet avec la réalité. L'épopée loufoque d'une bande de Pieds Nickelés missionnés par le président des États-Unis pour "libérer l'Irak ".
Biographie de l'auteur
Après avoir dirigé les bureaux de Bagdad, du Caire et d'Asie du Sud-Est du Washington Post, Rajiv Chandrasekaran a couvert la guerre en Afghanistan en tant que correspondant de ce grand quotidien, dont il est aujourd'hui rédacteur en chef adjoint.
Il a obtenu le Samuel Johnson Prize pour cet ouvrage qui figurait également dans la liste des dix meilleurs livres de l'année 2007 du New York Times
Envoyé spécial à Bagdad, Rajiv Chandrasekaran a enquêté pendant un an et demi dans la Zone verte, cette " petite Amérique" recréée par l'administration Bush pour accueillir les spécialistes chargés de faire de l'Irak une démocratie moderne. Le journaliste décrit le quotidien de ces Américains vivant en plein centre d'un pays dévasté par les bombardements et en proie à l'anarchie.
C'est l'histoire, racontée de l'intérieur, d'une organisation qui s'obstine jusqu'à l'absurde à mettre en place des projets en décalage complet avec la réalité. L'épopée loufoque d'une bande de Pieds Nickelés missionnés par le président des États-Unis pour "libérer l'Irak ".
Biographie de l'auteur
Après avoir dirigé les bureaux de Bagdad, du Caire et d'Asie du Sud-Est du Washington Post, Rajiv Chandrasekaran a couvert la guerre en Afghanistan en tant que correspondant de ce grand quotidien, dont il est aujourd'hui rédacteur en chef adjoint.
Il a obtenu le Samuel Johnson Prize pour cet ouvrage qui figurait également dans la liste des dix meilleurs livres de l'année 2007 du New York Times


Commentaire