1. Aux origines de la presse algérienne de langue arabe :
Le premier journal imprimé qui parut en Algérie, fut un organe officiel bilingue : Le Moniteur Algérien, sorti le 27 janvier 1832. Quoi qu’on en dise souvent, ce ne fut pas le premier journal paru au Maghreb (dès 1820, à Ceuta, fut imprimé un hebdomadaire espagnol). Il ne fut pas non plus le premier en Afrique du Nord qui ait employé la typographie et l’alphabet arabe, puisque le pacha d’Égypte, Muhamad Ali, avait créé dès le 20 novembre 1828 un bi-hebdomadaire, Al-Waqa’i al-Misriyya ("Les Evénements d’Égypte") tiré à l’imprimerie Balaq. Ce journal officiel du gouvernement égyptien – et qui le resta jusqu’en 1914 – contenait aussi des articles d’information, généralement copiés dans les journaux français. Ce journal servit d’ailleurs de modèle au véritable Journal Officiel de langue arabe que créèrent les Français en 1847 : le bi-mensuel Al-Mubachchir. Cet organe, qui parut régulièrement pendant 81 ans jusqu’en 1928, était envoyé d’office à tous les fonctionnaires musulmans algériens, auxquels il apportait non seulement les textes officiels, mais aussi « des renseignements utiles afin que vos connaissances se développent au fur et à mesure que progressent les sciences et techniques ». Ce J.O. comprit donc des articles de vulgarisation et de culture générale longtemps rédigés par des fonctionnaires français et traduits en arabe. Plus tard, des journalistes algériens y furent associés, et Le Mobacher fut ainsi la première école de journalisme de l’Algérie musulmane.
Au-delà de ce journal officiel et de quelques autres organes officieux, aucun périodique arabe indépendant ne s’imprima en Algérie avant 1907. Cette lacune est d’autant plus impressionnante que, pendant ces années, 1847 à 1907, le monde arabe vit fleurir, en Égypte et en Syrie essentiellement, des centaines de journaux hebdomadaires ou quotidiens, dans une langue progressivement recréée, « langue de la renaissance musulmane » selon Louis Massignon, qui est devenue l’arabe moderne, Koinè de tout le Dar al-Islam. Au moment où La Revue du monde musulman saluait dès son premier numéro (novembre 1906) le développement de la presse arabe comme « une des manifestations les plus remarquables du mouvement d’évolution qui s’accentue rapidement dans les pays musulmans » et montrait le rôle modernisateur de cette presse auprès de « tous les Musulmans des classes libérales », aucun journal arabe n’était publié en Algérie.
Certes, on vit apparaître à Constantine, en janvier 1882 un hebdomadaire d’origine assez mystérieuse dont le titre en graphie française, El Mountakheb ("L’Élu" ou "Le Choisi" ?), pourrait laisser croire à un journal arabe. En fait, ce journal « indigénophile » était pour l’essentiel rédigé en français par des Français et les seuls textes arabes qui y figurent sont des pétitions authentiques ou des traductions d’articles français faites par Omar Brihmat. Ce journal politique, vraisemblablement animé et soutenu de Paris par la Société française pour la protection des Indigènes des colonies de P. Leroy-Beaulieu et de V. Schoelcher – « cette société de farceurs pour qui tous les moyens sont bons » selon Le républicain de Constantine – fut également combattu de Paris par un organe bilingue officieux L’Astre d’Orient lequel cessa, semble-t-il, de paraître quatre mois après la disparition d’El-Mountakheb. « La presse, voilà l’arme dont vous devez apprendre à vous servir ; elle peut soulever un monde » avait dit ce journal. On veilla à Alger à ce que cela ne se fit que le plus tard possible, au besoin en créant une feuille officieuse. Ce fut le cas pour An-Nasih ("Le Bon Conseiller) « rédigé en arabe courant » par un fonctionnaire, Gosselin, de 1899 à 1900. La direction des Affaires indigènes songea à publier cette même année, un journal moins médiocre, El-Djezaïri, mais y renonça. Son projet aboutit cependant, en 1903, avec Al-Maghrib, bi-hebdomadaire rédigé à Alger par un groupe de professeurs de la medersa officielle, lequel n’eut que 32 numéros.
En 1907 enfin, un bi-mensuel parut à Alger, le bien-nommé Al-Ihya ("La Revivcation"). Cette petite revue de huit pages, dirigée par une arabisante française, Mlle Desrayaux, avait pour buts la défense de la langue et de la culture arabes, « Le Progrès et la Fraternité ». N’ayant trouvé que 400 abonnés, elle disparut après quatre mois d’existence (14 février-14 mai 1907). On peut penser que le Gouverneur Général Jonnart qui tentait alors d’encourager la langue arabe trouva une autre formule. Le 7 mai 1907 sortit à Alger Kawkab Ifriqiya ("L’Étoile Nord-Africaine"), journal d’information rédigé par des lettrés algériens appartenant au « clergé musulman » ou à l’enseignement des medersas. Le rédacteur en chef, Mahmud Bendali dit Kahhul, était un fonctionnaire du culte proche de l’Administration. Ce journal bien peu indépendant n’en est pas moins tenu aujourd’hui encore en Algérie pour « le premier journal de langue arabe » parce qu’il était rédigé uniquement par des Algériens, dans une langue classique et un style châtié. Certains de ses rédacteurs n’hésitèrent pas, il est vrai, à fustiger le retard intellectuel de leurs coreligionnaires et à déplorer la décadence de la culture arabe. Le mufti malékite de Constantine, Ben Mouhoub Al-Mouloud, en multipliant les satires mordantes contre les préjugés de la bourgeoisie de sa ville y gagna une solide réputation et de nombreux ennemis.
Cependant d’autres périodiques, tout différents et rédigés presque exclusivement en français, furent publiés à partir de 1893. Ils constituent néanmoins une presse politique algérienne que j’ai naguère appelée la presse jeune-algérienne.
... /...
Le premier journal imprimé qui parut en Algérie, fut un organe officiel bilingue : Le Moniteur Algérien, sorti le 27 janvier 1832. Quoi qu’on en dise souvent, ce ne fut pas le premier journal paru au Maghreb (dès 1820, à Ceuta, fut imprimé un hebdomadaire espagnol). Il ne fut pas non plus le premier en Afrique du Nord qui ait employé la typographie et l’alphabet arabe, puisque le pacha d’Égypte, Muhamad Ali, avait créé dès le 20 novembre 1828 un bi-hebdomadaire, Al-Waqa’i al-Misriyya ("Les Evénements d’Égypte") tiré à l’imprimerie Balaq. Ce journal officiel du gouvernement égyptien – et qui le resta jusqu’en 1914 – contenait aussi des articles d’information, généralement copiés dans les journaux français. Ce journal servit d’ailleurs de modèle au véritable Journal Officiel de langue arabe que créèrent les Français en 1847 : le bi-mensuel Al-Mubachchir. Cet organe, qui parut régulièrement pendant 81 ans jusqu’en 1928, était envoyé d’office à tous les fonctionnaires musulmans algériens, auxquels il apportait non seulement les textes officiels, mais aussi « des renseignements utiles afin que vos connaissances se développent au fur et à mesure que progressent les sciences et techniques ». Ce J.O. comprit donc des articles de vulgarisation et de culture générale longtemps rédigés par des fonctionnaires français et traduits en arabe. Plus tard, des journalistes algériens y furent associés, et Le Mobacher fut ainsi la première école de journalisme de l’Algérie musulmane.
Au-delà de ce journal officiel et de quelques autres organes officieux, aucun périodique arabe indépendant ne s’imprima en Algérie avant 1907. Cette lacune est d’autant plus impressionnante que, pendant ces années, 1847 à 1907, le monde arabe vit fleurir, en Égypte et en Syrie essentiellement, des centaines de journaux hebdomadaires ou quotidiens, dans une langue progressivement recréée, « langue de la renaissance musulmane » selon Louis Massignon, qui est devenue l’arabe moderne, Koinè de tout le Dar al-Islam. Au moment où La Revue du monde musulman saluait dès son premier numéro (novembre 1906) le développement de la presse arabe comme « une des manifestations les plus remarquables du mouvement d’évolution qui s’accentue rapidement dans les pays musulmans » et montrait le rôle modernisateur de cette presse auprès de « tous les Musulmans des classes libérales », aucun journal arabe n’était publié en Algérie.
Certes, on vit apparaître à Constantine, en janvier 1882 un hebdomadaire d’origine assez mystérieuse dont le titre en graphie française, El Mountakheb ("L’Élu" ou "Le Choisi" ?), pourrait laisser croire à un journal arabe. En fait, ce journal « indigénophile » était pour l’essentiel rédigé en français par des Français et les seuls textes arabes qui y figurent sont des pétitions authentiques ou des traductions d’articles français faites par Omar Brihmat. Ce journal politique, vraisemblablement animé et soutenu de Paris par la Société française pour la protection des Indigènes des colonies de P. Leroy-Beaulieu et de V. Schoelcher – « cette société de farceurs pour qui tous les moyens sont bons » selon Le républicain de Constantine – fut également combattu de Paris par un organe bilingue officieux L’Astre d’Orient lequel cessa, semble-t-il, de paraître quatre mois après la disparition d’El-Mountakheb. « La presse, voilà l’arme dont vous devez apprendre à vous servir ; elle peut soulever un monde » avait dit ce journal. On veilla à Alger à ce que cela ne se fit que le plus tard possible, au besoin en créant une feuille officieuse. Ce fut le cas pour An-Nasih ("Le Bon Conseiller) « rédigé en arabe courant » par un fonctionnaire, Gosselin, de 1899 à 1900. La direction des Affaires indigènes songea à publier cette même année, un journal moins médiocre, El-Djezaïri, mais y renonça. Son projet aboutit cependant, en 1903, avec Al-Maghrib, bi-hebdomadaire rédigé à Alger par un groupe de professeurs de la medersa officielle, lequel n’eut que 32 numéros.
En 1907 enfin, un bi-mensuel parut à Alger, le bien-nommé Al-Ihya ("La Revivcation"). Cette petite revue de huit pages, dirigée par une arabisante française, Mlle Desrayaux, avait pour buts la défense de la langue et de la culture arabes, « Le Progrès et la Fraternité ». N’ayant trouvé que 400 abonnés, elle disparut après quatre mois d’existence (14 février-14 mai 1907). On peut penser que le Gouverneur Général Jonnart qui tentait alors d’encourager la langue arabe trouva une autre formule. Le 7 mai 1907 sortit à Alger Kawkab Ifriqiya ("L’Étoile Nord-Africaine"), journal d’information rédigé par des lettrés algériens appartenant au « clergé musulman » ou à l’enseignement des medersas. Le rédacteur en chef, Mahmud Bendali dit Kahhul, était un fonctionnaire du culte proche de l’Administration. Ce journal bien peu indépendant n’en est pas moins tenu aujourd’hui encore en Algérie pour « le premier journal de langue arabe » parce qu’il était rédigé uniquement par des Algériens, dans une langue classique et un style châtié. Certains de ses rédacteurs n’hésitèrent pas, il est vrai, à fustiger le retard intellectuel de leurs coreligionnaires et à déplorer la décadence de la culture arabe. Le mufti malékite de Constantine, Ben Mouhoub Al-Mouloud, en multipliant les satires mordantes contre les préjugés de la bourgeoisie de sa ville y gagna une solide réputation et de nombreux ennemis.
Cependant d’autres périodiques, tout différents et rédigés presque exclusivement en français, furent publiés à partir de 1893. Ils constituent néanmoins une presse politique algérienne que j’ai naguère appelée la presse jeune-algérienne.
... /...

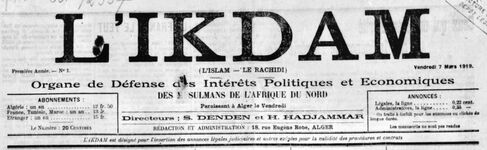

Commentaire