Peut-on croire encore au progrès alors même que pèse sur nous la menace d’une catastrophe totale? Comment se représenter un monde meilleur alors même que les limites planétaires se voient peu à peu toutes dépassées au point de menacer la survie de l’espèce? Est-il encore temps de faire le chemin inverse, à savoir de décroître pour progresser? Ex-trader à la Société Générale, Rodolphe Bocquet en livre une analyse profonde et saisissante pour QG
Mes amis me regardent souvent avec une circonspection amusée. Au cours de mes neuf CDI, j’ai fait mienne cette citation de Faust : « L’homme erre tant qu’il cherche[1]». Cette aspiration à un mieux-être est le moteur de mon progrès. Je prétends qu’elle me permet d’accéder à une plus riche compréhension du monde. Elle me fait aussi douter, me met régulièrement en risque et génère son lot de désillusions. Lorsque la pandémie a donné lieu à un mouvement massif de démissions[2], je me suis senti moins seul. Mais cette mise au pluriel de « génération désenchantée[3]» inquiète autant qu’elle réconforte ; la crise semble perdurer, voire s’aggraver. Alors, quand j’ai vu ce livre intitulé « Peut-on croire encore au progrès ? »[4], j’ai eu envie de savoir ce que sept intellectuels[5], réunis dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne en Novembre 2022, avaient à partager.

Grand amphithéâtre de La Sorbonne à Paris
Au sortir de ce banquet, la faim demeure et l’ulcère sourd. Les convives discourent mais aucun dialogue, encore moins de débat. La pitance est maigre et lorsque qu’un peu d’épices titille nos papilles, c’est la portion congrue[6]. Jean Viard s’emploie comme il peut mais l’improbable alchimie du soufflé au progrès ne prend plus. Quels que soient les arguments de rationalité, d’autorité, dont certains passablement faisandés.
En quelques mots, voici au sein des propos des intervenants, et des choix éditoriaux, ce qui ne passe pas : l’oubli de ceux qui questionnent le progrès comme moteur du progrès lui-même ; l’invention d’une peu aimable confrérie d’anti-progrès, passéistes, apeurés et dépourvus d’imaginaire ; une caricature éculée de la décroissance ; la radicalité présentée comme repoussoir dans une forme d’indécente légèreté face à ce qui est en jeu ; et in fine, l’absence de véritable proposition structurante pour sortir de ce que tout le monde, intervenants et nous, lecteur, s’accorde à qualifier de crise du progrès.
Mais ce livre, avec ses limites (format court, représentation probablement partielle des échanges du colloque et encore plus de la pensée des auteurs) a le mérite d’exister. Il m’a permis de creuser ce qu’il contenait pour moi d’irritant. Ce sont ces points saillants que j’ai choisi de détailler ici, emprunts de toute leur subjectivité. Il m’a donné envie de mettre en forme ma pensée, de faire certaines recherches, de lire d’autres livres. Bref, de progresser.
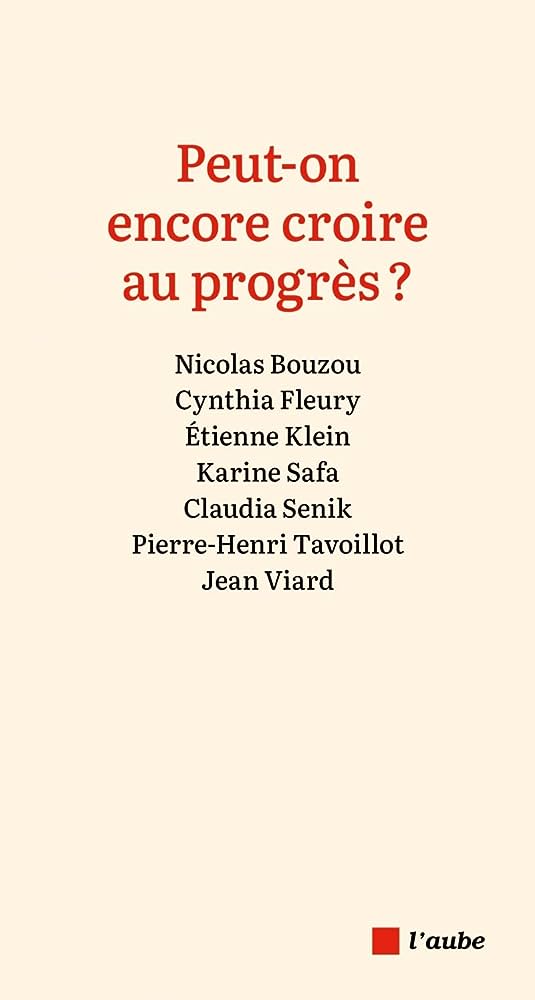
Couverture de l’ouvrage, aux éditions de l’Aube
Qu’est-ce que le progrès ?
Le progrès est par essence aigre-doux. Consolateur[7] et sacrificiel comme le dit Etienne Klein. « Croire au progrès, c’était accepter de sacrifier du présent personnel pour fabriquer du futur collectif ». Le progrès a un coût.
Ce coût revêt différents visages. Individuel pour le bénéfice collectif : les économies réalisées par des parents pour l’éducation de leurs enfants ou les investissements consentis pour la recherche médicale. Inversement, le progrès individuel peut se réaliser au prix d’une régression collective, comme c’est le cas de modes de vie ultra-carbonés mettant en péril l’humanité. Autres coûts, les habitudes que le progrès bouscule ou les inégalités qu’il génère lorsqu’il advient, privilégiant temporairement le groupe restreint qui en bénéficie initialement.
L’innovation n’est qu’un ingrédient du progrès. La condition de possibilité de celui-ci est que celle-là s’inscrive dans un prérequis spirituel, moral et politique. « Science sans conscience n’est que ruine de l’âme » écrivait Rabelais, ce qu’Etienne Klein précise « Nous ne pouvons pas savoir grâce à nos seules connaissances scientifiques ce que nous devons faire d’elles ». Cynthia Fleury esquisse le processus : « Il est d’abord nécessaire d’organiser un récit du progrès, d’en définir les contours et les bénéficiaires. Ensuite vient la mise en œuvre du progrès, sa matérialisation par le biais des politiques publiques ».
L’appétit pour le progrès croît en mangeant et chaque nouvelle bouchée coûte plus cher que la précédente[8]. Déplorer que les générations actuelles soient insatisfaites de l’absence de progrès et ne se montrent pas conscientes de mieux vivre que les précédentes ignore que le seul point de repère légitime pour elles est celui de leur enfance. Plus important, lorsque le niveau de conscience, d’éducation ou d’information d’un individu ou d’une population progresse, il en va de même de ses attentes envers son entourage, personnel, professionnel, social. L’une des conséquences immédiates des formations au management dans les organisations est d’accroître le niveau d’exigence envers les managers des personnes formées. Claudia Senik indique « Notre niveau d’exigence explique directement notre niveau de frustration », sans toutefois en tirer d’enseignements dans la relation au politique et les systèmes de gouvernance.
Enfin, des besoins quantitatifs et qualitatifs que le progrès vise à satisfaire, il en est un qui revêt un caractère fondamental : la possibilité de contribuer positivement à la communauté à laquelle on appartient. « Le lien social est un paramètre déterminant du niveau de satisfaction dans l’existence » (Claudia Senik, p.50). Un modèle économique et social qui construit de l’exclusion génère de ce fait structurellement de la régression. Une stratégie politique qui se nourrit de la division ne peut se revendiquer progressiste[9].
On aurait aimé être éclairés plus avant sur ces points. Que nenni. Voilà qu’en guise de plat de résistance on nous sert une déclinaison de fariboles confinant à l’escroquerie.

« Un modèle économique et social qui construit de l’exclusion génère de ce fait structurellement de la régression »
L’armée des opposants au progrès
Ainsi, il y aurait des « adversaires du progrès, nombreux (…) qui, contrairement aux courageux tenants du progrès revendiquant une forme de rationalité, tiennent des discours faisant appel aux sentiments » (Nicolas Bouzou, p.79 et 89), des gens « qui ne croient plus en la science », un « usage déréglé du doute (…) un pessimisme emportant tout, prenant des formes multiples et dont la technophobie n’est que la plus visible » (Karine Safa, p.73 et 75), des tenants d’une décroissance synonyme de « retour en arrière» (Claudia Senik, p.54) de « repli sur le passé» (Jean Viard, p.19) et « d’une volonté d’arrêter de grandir, antinomique avec la démocratie» (Pierre-Henri Tavoillot, p.39). Des populistes, des écologistes radicaux, des anti-vax et des trolls. Des personnes que la peur rend vulnérable au « complotisme comme schéma explicatif alternatif simple et apaisant » (Karine Safa, p.73), « désespérant du progrès et cédant à l’absurde (…) emprisonnant collectivement l’imaginaire dans la perspective négative des dystopies » (Karine Safa, p.73 et 77).
Détaillons cette tartufferie.
On n’échappe pas ici au tour de passe-passe consistant à peindre l’agressé en agresseur, à qualifier de conservateurs ceux qui aspirent à un autre monde.
Un minimum d’élégance aurait conduit à reconnaître la contribution essentielle de ces soi-disant anti-progrès à des avancées majeures qui apparaissent aujourd’hui comme des évidences. Jean Viard évoque brièvement René Dumont. On pourrait mentionner Ralph Nader, Rachel Carson, Dennis et Donella Meadows et tant d’autres individus ou ONGs, vilipendés en leur temps et sans lesquels les énergies renouvelables ou la Directive Reach ne seraient encore que des vues de l’esprit.
On pense aujourd’hui à Ines Léraud, Morgane Large, Nicolas Legendre et leur combat contre les dégâts causés par le lobby agro-industriel, dont les algues vertes. Le besoin encore et toujours de faire face à la collusion des forces économiques et politiques. Et non, la dénonciation du mandat de « prévention des actions de nature idéologique » de la cellule Demeter, des mensonges d’État ou de la dissolution des Soulèvements de la Terre ne relèvent pas d’un complotisme délirant. Pas plus que la mise en lumière des centaines de millions de dollars dépensés chaque année par l’industrie pétrolière pour freiner la lutte contre le changement climatique[10].
Ce n’est pas tant le citoyen qui ne croît plus en la science mais le politique qui la détourne pour son propre agenda sapant durablement la confiance. « Dormez tranquilles braves gens ! » du nuage de Tchernobyl à la vache folle[11], sans parler du récent et fâcheux Lancet gate. Des politiques qui ignorent les recommandations répétées du GIEC depuis 30 ans. Un Président qui lors de ses vœux en décembre 2022 déclare benoitement « qui aurait pu prédire la crise climatique aux effets spectaculaires cet été dans notre pays ?». Le ministre de l’Agriculture, dont l’ex-cheffe de cabinet est désormais directrice de la communication et des affaires publiques du lobby des pesticides, qui lui emboite le pas six mois plus tard, provoquant l’ire de climatologues[12] : « On n’a pas eu des températures extrêmes, on a plutôt eu des températures normales, pour un été ». Une semaine plus tôt, le service Copernicus et l’Organisation Mondiale Météorologique (OMM) qualifiaient le mois de juin 2023 comme le plus chaud jamais enregistré, avec des températures de surface de la mer en Atlantique Nord « hors norme » et « une étendue de la banquise arctique d’une faiblesse record ».
Rappelons, comme nous l’apprend dans son excellent livre Sylvestre Huet[13], que le GIEC a initialement été créé avec l’aval de Reagan et Thatcher dans une tentative de contrebalancer l’influence des environnementalistes du PNUE ! Quelque part entre 2006 et 2009, je participais à une réunion à l’Hôtel de Roquelaure avec le Directeur de Cabinet du ministre de l’Environnement. A la fin de l’échange, l’ordre du jour traité, l’ambiance détendue et se sentant en confiance, celui-ci nous partagea cette confidence : « L’environnement, c’est bien, mais ça s’arrête là où commence l’économie. »
Les désenchantés seraient mus par la peur et se refuseraient à évoluer. Ce sont bien plutôt les tenants des modes de production et de consommation du monde d’hier sur lesquels reposent leurs profits, qui s’accrochent à un paradigme mortifère comme une moule à son rocher. Quel courage il faut pour contempler dans les yeux l’abime vers lequel nous nous dirigeons. J’expliquais l’autre jour l’ampleur de la crise climatique à des cadres financiers lors d’un déjeuner, ils me reprochèrent de leur couper l’appétit « Mais c’est très anxiogène tout ça ! ».
 « L’environnement, c’est bien, mais ça s’arrête là où commence l’économie. »
« L’environnement, c’est bien, mais ça s’arrête là où commence l’économie. »
« Un autre monde est possible », « Rêve général » autant de slogans et d’utopies portés depuis 50 ans. En 1975 paraissait l’inspirant Ecotopia (Ernest Callenbach, Gallimard 1975). Plutôt que de déplorer la floraison de dystopies et la solastalgie, n’en déplaise à Karine Safa, il serait autrement plus utile de s’interroger sur ce qui broie les utopies. Le 11 Septembre 1973, Salvador Allende déclarait à la radio nationale « L’humanité avance (idéalement) vers la conquête d’une vie meilleure ». Ce fut son dernier discours. Un peu de décence, de grâce !
Mes amis me regardent souvent avec une circonspection amusée. Au cours de mes neuf CDI, j’ai fait mienne cette citation de Faust : « L’homme erre tant qu’il cherche[1]». Cette aspiration à un mieux-être est le moteur de mon progrès. Je prétends qu’elle me permet d’accéder à une plus riche compréhension du monde. Elle me fait aussi douter, me met régulièrement en risque et génère son lot de désillusions. Lorsque la pandémie a donné lieu à un mouvement massif de démissions[2], je me suis senti moins seul. Mais cette mise au pluriel de « génération désenchantée[3]» inquiète autant qu’elle réconforte ; la crise semble perdurer, voire s’aggraver. Alors, quand j’ai vu ce livre intitulé « Peut-on croire encore au progrès ? »[4], j’ai eu envie de savoir ce que sept intellectuels[5], réunis dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne en Novembre 2022, avaient à partager.

Grand amphithéâtre de La Sorbonne à Paris
Au sortir de ce banquet, la faim demeure et l’ulcère sourd. Les convives discourent mais aucun dialogue, encore moins de débat. La pitance est maigre et lorsque qu’un peu d’épices titille nos papilles, c’est la portion congrue[6]. Jean Viard s’emploie comme il peut mais l’improbable alchimie du soufflé au progrès ne prend plus. Quels que soient les arguments de rationalité, d’autorité, dont certains passablement faisandés.
En quelques mots, voici au sein des propos des intervenants, et des choix éditoriaux, ce qui ne passe pas : l’oubli de ceux qui questionnent le progrès comme moteur du progrès lui-même ; l’invention d’une peu aimable confrérie d’anti-progrès, passéistes, apeurés et dépourvus d’imaginaire ; une caricature éculée de la décroissance ; la radicalité présentée comme repoussoir dans une forme d’indécente légèreté face à ce qui est en jeu ; et in fine, l’absence de véritable proposition structurante pour sortir de ce que tout le monde, intervenants et nous, lecteur, s’accorde à qualifier de crise du progrès.
Mais ce livre, avec ses limites (format court, représentation probablement partielle des échanges du colloque et encore plus de la pensée des auteurs) a le mérite d’exister. Il m’a permis de creuser ce qu’il contenait pour moi d’irritant. Ce sont ces points saillants que j’ai choisi de détailler ici, emprunts de toute leur subjectivité. Il m’a donné envie de mettre en forme ma pensée, de faire certaines recherches, de lire d’autres livres. Bref, de progresser.
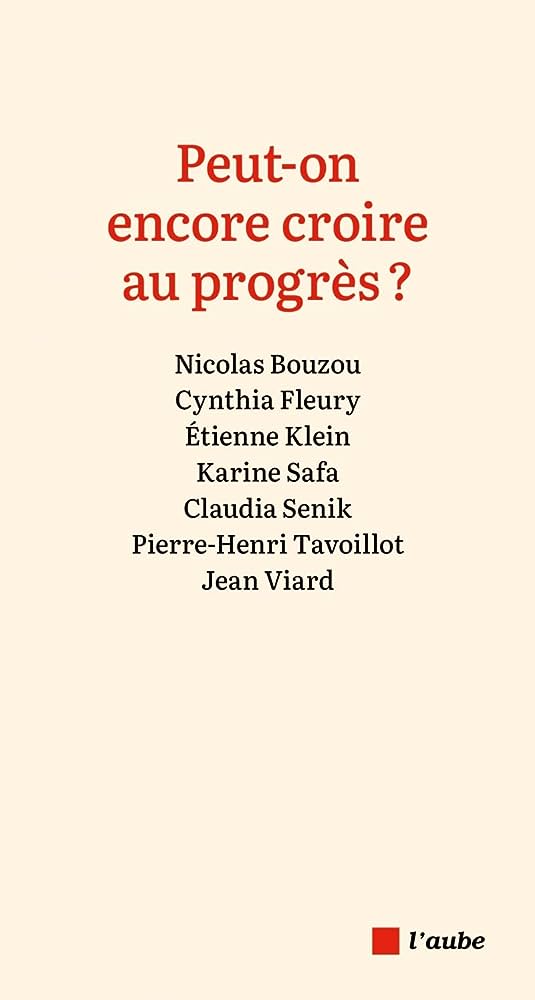
Couverture de l’ouvrage, aux éditions de l’Aube
Qu’est-ce que le progrès ?
Le progrès est par essence aigre-doux. Consolateur[7] et sacrificiel comme le dit Etienne Klein. « Croire au progrès, c’était accepter de sacrifier du présent personnel pour fabriquer du futur collectif ». Le progrès a un coût.
Ce coût revêt différents visages. Individuel pour le bénéfice collectif : les économies réalisées par des parents pour l’éducation de leurs enfants ou les investissements consentis pour la recherche médicale. Inversement, le progrès individuel peut se réaliser au prix d’une régression collective, comme c’est le cas de modes de vie ultra-carbonés mettant en péril l’humanité. Autres coûts, les habitudes que le progrès bouscule ou les inégalités qu’il génère lorsqu’il advient, privilégiant temporairement le groupe restreint qui en bénéficie initialement.
L’innovation n’est qu’un ingrédient du progrès. La condition de possibilité de celui-ci est que celle-là s’inscrive dans un prérequis spirituel, moral et politique. « Science sans conscience n’est que ruine de l’âme » écrivait Rabelais, ce qu’Etienne Klein précise « Nous ne pouvons pas savoir grâce à nos seules connaissances scientifiques ce que nous devons faire d’elles ». Cynthia Fleury esquisse le processus : « Il est d’abord nécessaire d’organiser un récit du progrès, d’en définir les contours et les bénéficiaires. Ensuite vient la mise en œuvre du progrès, sa matérialisation par le biais des politiques publiques ».
L’appétit pour le progrès croît en mangeant et chaque nouvelle bouchée coûte plus cher que la précédente[8]. Déplorer que les générations actuelles soient insatisfaites de l’absence de progrès et ne se montrent pas conscientes de mieux vivre que les précédentes ignore que le seul point de repère légitime pour elles est celui de leur enfance. Plus important, lorsque le niveau de conscience, d’éducation ou d’information d’un individu ou d’une population progresse, il en va de même de ses attentes envers son entourage, personnel, professionnel, social. L’une des conséquences immédiates des formations au management dans les organisations est d’accroître le niveau d’exigence envers les managers des personnes formées. Claudia Senik indique « Notre niveau d’exigence explique directement notre niveau de frustration », sans toutefois en tirer d’enseignements dans la relation au politique et les systèmes de gouvernance.
Enfin, des besoins quantitatifs et qualitatifs que le progrès vise à satisfaire, il en est un qui revêt un caractère fondamental : la possibilité de contribuer positivement à la communauté à laquelle on appartient. « Le lien social est un paramètre déterminant du niveau de satisfaction dans l’existence » (Claudia Senik, p.50). Un modèle économique et social qui construit de l’exclusion génère de ce fait structurellement de la régression. Une stratégie politique qui se nourrit de la division ne peut se revendiquer progressiste[9].
On aurait aimé être éclairés plus avant sur ces points. Que nenni. Voilà qu’en guise de plat de résistance on nous sert une déclinaison de fariboles confinant à l’escroquerie.

« Un modèle économique et social qui construit de l’exclusion génère de ce fait structurellement de la régression »
L’armée des opposants au progrès
Ainsi, il y aurait des « adversaires du progrès, nombreux (…) qui, contrairement aux courageux tenants du progrès revendiquant une forme de rationalité, tiennent des discours faisant appel aux sentiments » (Nicolas Bouzou, p.79 et 89), des gens « qui ne croient plus en la science », un « usage déréglé du doute (…) un pessimisme emportant tout, prenant des formes multiples et dont la technophobie n’est que la plus visible » (Karine Safa, p.73 et 75), des tenants d’une décroissance synonyme de « retour en arrière» (Claudia Senik, p.54) de « repli sur le passé» (Jean Viard, p.19) et « d’une volonté d’arrêter de grandir, antinomique avec la démocratie» (Pierre-Henri Tavoillot, p.39). Des populistes, des écologistes radicaux, des anti-vax et des trolls. Des personnes que la peur rend vulnérable au « complotisme comme schéma explicatif alternatif simple et apaisant » (Karine Safa, p.73), « désespérant du progrès et cédant à l’absurde (…) emprisonnant collectivement l’imaginaire dans la perspective négative des dystopies » (Karine Safa, p.73 et 77).
Détaillons cette tartufferie.
On n’échappe pas ici au tour de passe-passe consistant à peindre l’agressé en agresseur, à qualifier de conservateurs ceux qui aspirent à un autre monde.
Un minimum d’élégance aurait conduit à reconnaître la contribution essentielle de ces soi-disant anti-progrès à des avancées majeures qui apparaissent aujourd’hui comme des évidences. Jean Viard évoque brièvement René Dumont. On pourrait mentionner Ralph Nader, Rachel Carson, Dennis et Donella Meadows et tant d’autres individus ou ONGs, vilipendés en leur temps et sans lesquels les énergies renouvelables ou la Directive Reach ne seraient encore que des vues de l’esprit.
On pense aujourd’hui à Ines Léraud, Morgane Large, Nicolas Legendre et leur combat contre les dégâts causés par le lobby agro-industriel, dont les algues vertes. Le besoin encore et toujours de faire face à la collusion des forces économiques et politiques. Et non, la dénonciation du mandat de « prévention des actions de nature idéologique » de la cellule Demeter, des mensonges d’État ou de la dissolution des Soulèvements de la Terre ne relèvent pas d’un complotisme délirant. Pas plus que la mise en lumière des centaines de millions de dollars dépensés chaque année par l’industrie pétrolière pour freiner la lutte contre le changement climatique[10].
Ce n’est pas tant le citoyen qui ne croît plus en la science mais le politique qui la détourne pour son propre agenda sapant durablement la confiance. « Dormez tranquilles braves gens ! » du nuage de Tchernobyl à la vache folle[11], sans parler du récent et fâcheux Lancet gate. Des politiques qui ignorent les recommandations répétées du GIEC depuis 30 ans. Un Président qui lors de ses vœux en décembre 2022 déclare benoitement « qui aurait pu prédire la crise climatique aux effets spectaculaires cet été dans notre pays ?». Le ministre de l’Agriculture, dont l’ex-cheffe de cabinet est désormais directrice de la communication et des affaires publiques du lobby des pesticides, qui lui emboite le pas six mois plus tard, provoquant l’ire de climatologues[12] : « On n’a pas eu des températures extrêmes, on a plutôt eu des températures normales, pour un été ». Une semaine plus tôt, le service Copernicus et l’Organisation Mondiale Météorologique (OMM) qualifiaient le mois de juin 2023 comme le plus chaud jamais enregistré, avec des températures de surface de la mer en Atlantique Nord « hors norme » et « une étendue de la banquise arctique d’une faiblesse record ».
Rappelons, comme nous l’apprend dans son excellent livre Sylvestre Huet[13], que le GIEC a initialement été créé avec l’aval de Reagan et Thatcher dans une tentative de contrebalancer l’influence des environnementalistes du PNUE ! Quelque part entre 2006 et 2009, je participais à une réunion à l’Hôtel de Roquelaure avec le Directeur de Cabinet du ministre de l’Environnement. A la fin de l’échange, l’ordre du jour traité, l’ambiance détendue et se sentant en confiance, celui-ci nous partagea cette confidence : « L’environnement, c’est bien, mais ça s’arrête là où commence l’économie. »
Les désenchantés seraient mus par la peur et se refuseraient à évoluer. Ce sont bien plutôt les tenants des modes de production et de consommation du monde d’hier sur lesquels reposent leurs profits, qui s’accrochent à un paradigme mortifère comme une moule à son rocher. Quel courage il faut pour contempler dans les yeux l’abime vers lequel nous nous dirigeons. J’expliquais l’autre jour l’ampleur de la crise climatique à des cadres financiers lors d’un déjeuner, ils me reprochèrent de leur couper l’appétit « Mais c’est très anxiogène tout ça ! ».
 « L’environnement, c’est bien, mais ça s’arrête là où commence l’économie. »
« L’environnement, c’est bien, mais ça s’arrête là où commence l’économie. »« Un autre monde est possible », « Rêve général » autant de slogans et d’utopies portés depuis 50 ans. En 1975 paraissait l’inspirant Ecotopia (Ernest Callenbach, Gallimard 1975). Plutôt que de déplorer la floraison de dystopies et la solastalgie, n’en déplaise à Karine Safa, il serait autrement plus utile de s’interroger sur ce qui broie les utopies. Le 11 Septembre 1973, Salvador Allende déclarait à la radio nationale « L’humanité avance (idéalement) vers la conquête d’une vie meilleure ». Ce fut son dernier discours. Un peu de décence, de grâce !






Commentaire