Dans son dernier ouvrage « Les Nouveaux Serfs de l’économie », l’ancien ministre des finances grec Yánis Varoufákis défend l’idée que le capitalisme a laissé place au techno-féodalisme. Une forme de mise en garde contre de nouveaux modes de domination.
Les conséquences de la crise actuelle du capitalisme intéressent de plus en plus d’économistes. Du moins ceux qui ne se contentent pas d’une vision apologétique de l’actuel mode de production. Une analyse commence à émerger dans ce cadre, celui du « techno-féodalisme », autrement dit l’idée que le mode actuel de production est dominé par les grandes entreprises technologiques qui se rémunèrent sur des rentes numériques et non plus sur un système de profit issu de marchés concurrentiels.
L’idée avait été développée en France par Cédric Durand dans son ouvrage Techno-féodalisme (La Découverte, 2020), qui vient d’être traduit en anglais. Yánis Varoufákis, ancien ministre grec des finances durant l’acmé de la crise en 2015, défend la même idée sous un angle légèrement différent dans son dernier ouvrage, Les Nouveaux Serfs de l’économie (Les liens qui libèrent, 2024), qui vient de sortir en français et dont le titre anglais, lors de sa parution en 2023, était Technofeudalism : What Killed Capitalism (« Techno-féodalisme : ce qui a tué le capitalisme »).
Si Cédric Durand insistait sur la dynamique interne à « l’idéologie de la Silicon Valley » et son lien avec la crise du capitalisme, Yánis Varoufákis reprend sa réflexion à partir de son précédent ouvrage théorique, Le Minotaure planétaire (traduit en français en 2015 aux Éditions du Cercle). Il y décrivait la logique de la financiarisation du capitalisme d’avant la crise de 2008 fondée sur le recyclage par Wall Street des excédents commerciaux allemands et chinois.
Ce monde s’est effondré avec Lehman Brothers et le sauvetage des banques centrales a permis, selon Yánis Varoufákis, aux grandes entreprises de la tech de construire un nouveau système de domination du capitalisme. Pour l’ancien ministre grec, ce système n’est plus capitaliste, dans la mesure où il s’extrait des marchés et du profit. Mais pour exister, il doit se greffer sur le capitalisme traditionnel, où dominent la concurrence, le profit et les marchés.
 Agrandir l’image : Illustration 1Yánis Varoufákis lors d’un rassemblement du parti parti MeRA25 à Athènes le 4 juin 2024. © Photo Dimitris Aspiotis / Pacific Press / ZUMA / REA
Agrandir l’image : Illustration 1Yánis Varoufákis lors d’un rassemblement du parti parti MeRA25 à Athènes le 4 juin 2024. © Photo Dimitris Aspiotis / Pacific Press / ZUMA / REA
Le texte de Yánis Varoufákis est fidèle au personnage lui-même, rempli de références à la culture pop et rédigé comme une sorte de longue lettre à son père. Chacun jugera si ces méthodes favorisent ou non la lecture. L’usage du terme « techno-féodalisme » et la proclamation de la mort du capitalisme pour « quelque chose de pire », entre dans ce cadre. Il est volontairement provocateur pour amener un sursaut que l’on peut juger salutaire : il n’est plus possible de mener les luttes sociales et politiques comme auparavant.
Pirouette
Reste à savoir si l’on a besoin de ce concept de nouveau féodalisme ou si l’on doit, au contraire, comprendre ce qu’il y a encore de capitaliste dans cette nouvelle structure. C’est un débat théorique qui peut sembler technique et vain. Mais, en réalité, il est crucial : en régime techno-féodal, l’essentiel de la lutte doit porter sur les géants de la technologie, qui sont les forces dominantes de l’histoire. Le capitalisme apparaîtrait même comme un « moindre mal » dans ce cadre, et le combat contre le secteur capitaliste vassalisé est un peu vain.
Mais en se focalisant sur la critique de la rente numérique, ne manque-t-on pas ce que ce régime a de commun avec le capitalisme :celui de la séparation à l’œuvre dans le travail et dans la marchandise, et la centralité de l’extraction de valeur. De ce point de vue, Yánis Varoufákis réalise une pirouette en faisant du techno-féodalisme une forme nouvelle de domination du capital, ce qui lui permet de revenir à des objectifs classiques de la lutte anticapitaliste.
Le techno-féodalisme ressemble davantage à un nouveau mode de coordination de la production qu’à un nouveau mode de production en lui-même. Dans ce cas, on serait cependant plus proches d’une forme d’oligopole que le système lui-même serait capable d’intégrer et de dépasser pour préserver le cœur du réacteur du système : la domination du capital.
Conserver le terme de capitalisme permettrait donc d’éviter de se leurrer dans une lutte partielle contre une facette d’un système plus que contre son moteur lui-même. De fait, l’ouvrage de Yánis Varoufákis ne s’étend guère sur ce que le techno-féodalisme modifie en profondeur dans le monde du travail.
Reste l’idée d’une dérive rentière du capitalisme qui s’appuie, quoi qu’on pense du concept de techno-féodalisme, sur des faits évidents. La puissance croissante des grandes entreprises du numérique modifie profondément le fonctionnement de l’économie et il est indispensable d’intégrer cette dimension dans les luttes sociales. En cela, l’ouvrage de l’ancien ministre grec apporte d’utiles réflexions et des débats importants.
Mediapart : Vous décrivez l’avènement du « techno-féodalisme » comme la conséquence de la financiarisation du capitalisme, que vous décriviez dans « Le Minotaure planétaire ». Comment s’est organisé le basculement ?
Yánis Varoufákis : Les blessures de la crise de 2008 ne sont en réalité jamais refermées. Il n’a jamais été possible de revenir à l’époque précédente. En remettant à flot le système financier après la crise, les banques centrales ont créé des masses d’argent considérables, pas moins de 35 000 milliards de dollars. Parallèlement, on a établi de l’austérité partout, ce qui a conduit à réduire la demande et l’investissement. Où placer alors ces 35 000 milliards de dollars ? Les seuls capitalistes qui investissaient alors, c’étaient les grandes firmes technologiques, les « Big Tech ».
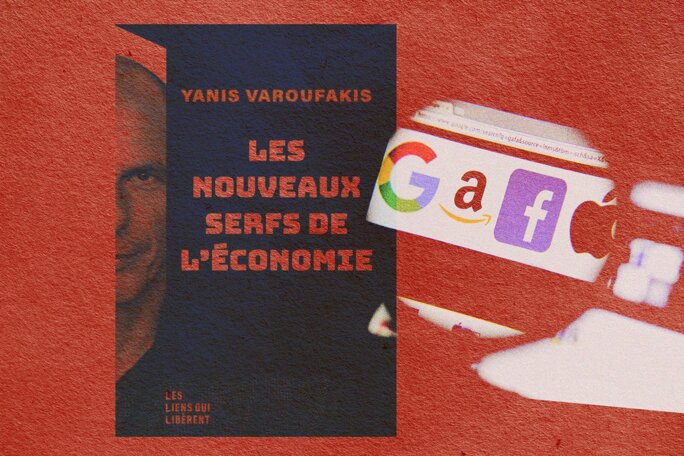
Agrandir l’image : Illustration 2© Photomontage Mediapart
Les banques centrales ont donc permis l’émergence de ce que j’appelle le « capital cloud » qui, selon mon hypothèse, est une forme de capital nouvelle et toxique. Des sources au cœur de ces Big Tech m’ont d’ailleurs confirmé que la moitié de l’argent qui a permis ces investissements provenait des banques centrales.
Ce n’est pas étonnant. L’émergence du capitalisme sur le féodalisme s’est organisée dans les pays comme le Royaume-Uni ou la France, où il y avait un État fort. Aujourd’hui, ce sont les banques centrales, une autre puissance étatique, qui ont permis de construire la transition vers le « techno-féodalisme ».
Un des points centraux de votre thèse est que le « techno-féodalisme » a remplacé le capitalisme. Mais si le capitalisme est le mode de production dans lequel règne le capital, en quoi la domination du « capital cloud » change-t-elle fondamentalement la donne ?
Le capitalisme et le techno-féodalisme sont tous les deux gouvernés par le capital, et on pourrait dire que le techno-féodalisme est une forme de capitalisme. Mais je vois une différence fondamentale. Dans les définitions qui sont généralement admises du capitalisme et qui découlent notamment d’Adam Smith, il existe deux piliers centraux au capitalisme : le marché et le profit. Or, dans le techno-féodalisme, ces deux piliers sont inopérants.
Le marché est remplacé par des plateformes centralisées qui ressemblent davantage à un « Gosplan » privé [le Gosplan était l’administration centrale de gestion du plan soviétique – ndlr] et les profits sont remplacés par des rentes qui sont payées par les capitalistes à l’ancienne pour accéder à ces plateformes. Le capital cloud est donc une mutation du capital, une forme différente de capital qui ne produit pas de moyens de production, mais domine la production.
J’aurais pu appeler ce système le « capitalism cloud », et cela n’aurait pas été faux, mais je pense qu’il faut concentrer nos esprits sur le fait que cette organisation est très radicalement différente. Au début du XIXe siècle, il aurait été juste de parler de « féodalisme industriel » ou de « féodalisme de marché », mais en inventant le terme « capitalisme », on a pris conscience du caractère nouveau de ce qui se mettait en place.
N’y a-t-il réellement plus de marché dans le techno-féodalisme ? Plusieurs acteurs semblent pourtant mener une compétition pour se partager leurs marchés.
Ce n’est pas de la concurrence, mais de la rivalité. La rivalité existait entre les seigneurs féodaux. Certains ont disparu, d’autres ont prospéré en absorbant leurs rivaux. Le système féodal n’était pas statique.

Agrandir l’image : Illustration 3© Photo illustration Sébastien Calvet / Mediapart
Dans le cas présent, si on prend par exemple les cas d’Instagram et de TikTok, on constate qu’il n’existe pas de marchés concurrentiels. On ne va pas sur l’un parce que l’on est déçu de l’autre. La concurrence, c’est de pouvoir changer de prestataire sans aucun coût. Ici, il existe un coût non monétaire. J’ai un million d’abonnés sur Twitter et une centaine sur Bluesky : l’existence de Bluesky ne permet pas d’offrir une alternative à l’usage de Twitter. Il est certes possible de s’échapper de cette emprise à titre personnel, mais la logique globale est celle de la capture.
Vous estimez que la rente a remplacé le profit comme moteur du système, mais comme les grandes entreprises technologiques continuent à dépendre de la production capitaliste classique, la production de valeur, et donc le profit, ne reste-t-elle pas centrale ?
Le profit n’a évidemment pas disparu. Il est simplement désormais dominé par la rente. Mais il ne fait aucun doute que la production de plus-value reste un élément important du système. Il faut cependant ajouter à cela une nouveauté, le « travail gratuit » réalisé par les utilisateurs des plateformes qui viennent alimenter les algorithmes, qui ne produit pas de valeur en tant que telle, mais que les techno-capitalistes utilisent pour améliorer leurs algorithmes et capter davantage de plus-value via la rente.
Cela signifie-t-il néanmoins que les contradictions propres à la production de valeur dans le capitalisme restent d’actualité dans le techno-féodalisme ?
Oui, mais parce que ces contradictions sont propres au capital, qui est à la fois une marchandise et une relation sociale, pas au capitalisme. Dans le cadre techno-féodal, cette contradiction non seulement persiste, mais elle est encore plus prévalente.
Dès lors, la croissance devient-elle une nécessité pour le techno-féodalisme ?
Le techno-féodalisme a effectivement besoin de la croissance du secteur capitaliste traditionnel pour maintenir le versement de la rente au « capital cloud ». C’est en cela que ce système est beaucoup plus instable que le capitalisme classique.
La dépendance du techno-féodalisme au secteur capitaliste classique n’induit-elle pas une remise en cause de l’idée qu’il s’agit là d’un nouveau mode de production ?
Non, parce que, par exemple, le capitalisme a longtemps coexisté avec un secteur féodal persistant que l’on retrouve dans les rentes financières ou immobilières. De la même façon, les techno-féodaux ont besoin du secteur capitaliste, mais le dominent. Ce sont eux qui sont au centre du système.
Les conséquences de la crise actuelle du capitalisme intéressent de plus en plus d’économistes. Du moins ceux qui ne se contentent pas d’une vision apologétique de l’actuel mode de production. Une analyse commence à émerger dans ce cadre, celui du « techno-féodalisme », autrement dit l’idée que le mode actuel de production est dominé par les grandes entreprises technologiques qui se rémunèrent sur des rentes numériques et non plus sur un système de profit issu de marchés concurrentiels.
L’idée avait été développée en France par Cédric Durand dans son ouvrage Techno-féodalisme (La Découverte, 2020), qui vient d’être traduit en anglais. Yánis Varoufákis, ancien ministre grec des finances durant l’acmé de la crise en 2015, défend la même idée sous un angle légèrement différent dans son dernier ouvrage, Les Nouveaux Serfs de l’économie (Les liens qui libèrent, 2024), qui vient de sortir en français et dont le titre anglais, lors de sa parution en 2023, était Technofeudalism : What Killed Capitalism (« Techno-féodalisme : ce qui a tué le capitalisme »).
Si Cédric Durand insistait sur la dynamique interne à « l’idéologie de la Silicon Valley » et son lien avec la crise du capitalisme, Yánis Varoufákis reprend sa réflexion à partir de son précédent ouvrage théorique, Le Minotaure planétaire (traduit en français en 2015 aux Éditions du Cercle). Il y décrivait la logique de la financiarisation du capitalisme d’avant la crise de 2008 fondée sur le recyclage par Wall Street des excédents commerciaux allemands et chinois.
Ce monde s’est effondré avec Lehman Brothers et le sauvetage des banques centrales a permis, selon Yánis Varoufákis, aux grandes entreprises de la tech de construire un nouveau système de domination du capitalisme. Pour l’ancien ministre grec, ce système n’est plus capitaliste, dans la mesure où il s’extrait des marchés et du profit. Mais pour exister, il doit se greffer sur le capitalisme traditionnel, où dominent la concurrence, le profit et les marchés.
 Agrandir l’image : Illustration 1Yánis Varoufákis lors d’un rassemblement du parti parti MeRA25 à Athènes le 4 juin 2024. © Photo Dimitris Aspiotis / Pacific Press / ZUMA / REA
Agrandir l’image : Illustration 1Yánis Varoufákis lors d’un rassemblement du parti parti MeRA25 à Athènes le 4 juin 2024. © Photo Dimitris Aspiotis / Pacific Press / ZUMA / REALe texte de Yánis Varoufákis est fidèle au personnage lui-même, rempli de références à la culture pop et rédigé comme une sorte de longue lettre à son père. Chacun jugera si ces méthodes favorisent ou non la lecture. L’usage du terme « techno-féodalisme » et la proclamation de la mort du capitalisme pour « quelque chose de pire », entre dans ce cadre. Il est volontairement provocateur pour amener un sursaut que l’on peut juger salutaire : il n’est plus possible de mener les luttes sociales et politiques comme auparavant.
Pirouette
Reste à savoir si l’on a besoin de ce concept de nouveau féodalisme ou si l’on doit, au contraire, comprendre ce qu’il y a encore de capitaliste dans cette nouvelle structure. C’est un débat théorique qui peut sembler technique et vain. Mais, en réalité, il est crucial : en régime techno-féodal, l’essentiel de la lutte doit porter sur les géants de la technologie, qui sont les forces dominantes de l’histoire. Le capitalisme apparaîtrait même comme un « moindre mal » dans ce cadre, et le combat contre le secteur capitaliste vassalisé est un peu vain.
Mais en se focalisant sur la critique de la rente numérique, ne manque-t-on pas ce que ce régime a de commun avec le capitalisme :celui de la séparation à l’œuvre dans le travail et dans la marchandise, et la centralité de l’extraction de valeur. De ce point de vue, Yánis Varoufákis réalise une pirouette en faisant du techno-féodalisme une forme nouvelle de domination du capital, ce qui lui permet de revenir à des objectifs classiques de la lutte anticapitaliste.
Le techno-féodalisme ressemble davantage à un nouveau mode de coordination de la production qu’à un nouveau mode de production en lui-même. Dans ce cas, on serait cependant plus proches d’une forme d’oligopole que le système lui-même serait capable d’intégrer et de dépasser pour préserver le cœur du réacteur du système : la domination du capital.
Conserver le terme de capitalisme permettrait donc d’éviter de se leurrer dans une lutte partielle contre une facette d’un système plus que contre son moteur lui-même. De fait, l’ouvrage de Yánis Varoufákis ne s’étend guère sur ce que le techno-féodalisme modifie en profondeur dans le monde du travail.
Reste l’idée d’une dérive rentière du capitalisme qui s’appuie, quoi qu’on pense du concept de techno-féodalisme, sur des faits évidents. La puissance croissante des grandes entreprises du numérique modifie profondément le fonctionnement de l’économie et il est indispensable d’intégrer cette dimension dans les luttes sociales. En cela, l’ouvrage de l’ancien ministre grec apporte d’utiles réflexions et des débats importants.
Mediapart : Vous décrivez l’avènement du « techno-féodalisme » comme la conséquence de la financiarisation du capitalisme, que vous décriviez dans « Le Minotaure planétaire ». Comment s’est organisé le basculement ?
Yánis Varoufákis : Les blessures de la crise de 2008 ne sont en réalité jamais refermées. Il n’a jamais été possible de revenir à l’époque précédente. En remettant à flot le système financier après la crise, les banques centrales ont créé des masses d’argent considérables, pas moins de 35 000 milliards de dollars. Parallèlement, on a établi de l’austérité partout, ce qui a conduit à réduire la demande et l’investissement. Où placer alors ces 35 000 milliards de dollars ? Les seuls capitalistes qui investissaient alors, c’étaient les grandes firmes technologiques, les « Big Tech ».
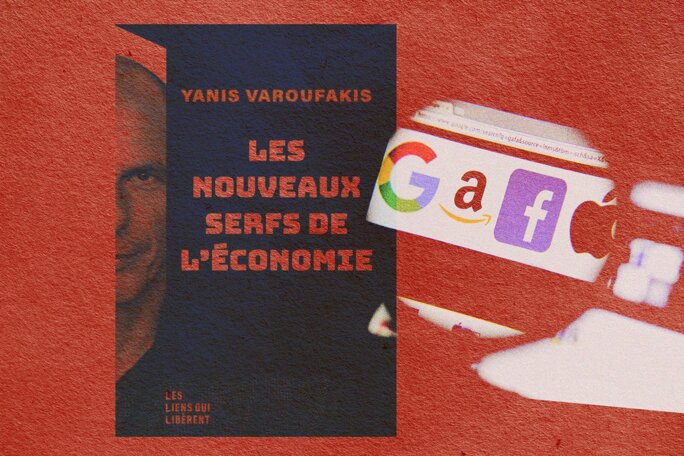
Agrandir l’image : Illustration 2© Photomontage Mediapart
Les banques centrales ont donc permis l’émergence de ce que j’appelle le « capital cloud » qui, selon mon hypothèse, est une forme de capital nouvelle et toxique. Des sources au cœur de ces Big Tech m’ont d’ailleurs confirmé que la moitié de l’argent qui a permis ces investissements provenait des banques centrales.
Ce n’est pas étonnant. L’émergence du capitalisme sur le féodalisme s’est organisée dans les pays comme le Royaume-Uni ou la France, où il y avait un État fort. Aujourd’hui, ce sont les banques centrales, une autre puissance étatique, qui ont permis de construire la transition vers le « techno-féodalisme ».
Un des points centraux de votre thèse est que le « techno-féodalisme » a remplacé le capitalisme. Mais si le capitalisme est le mode de production dans lequel règne le capital, en quoi la domination du « capital cloud » change-t-elle fondamentalement la donne ?
Le capitalisme et le techno-féodalisme sont tous les deux gouvernés par le capital, et on pourrait dire que le techno-féodalisme est une forme de capitalisme. Mais je vois une différence fondamentale. Dans les définitions qui sont généralement admises du capitalisme et qui découlent notamment d’Adam Smith, il existe deux piliers centraux au capitalisme : le marché et le profit. Or, dans le techno-féodalisme, ces deux piliers sont inopérants.
Le marché est remplacé par des plateformes centralisées qui ressemblent davantage à un « Gosplan » privé [le Gosplan était l’administration centrale de gestion du plan soviétique – ndlr] et les profits sont remplacés par des rentes qui sont payées par les capitalistes à l’ancienne pour accéder à ces plateformes. Le capital cloud est donc une mutation du capital, une forme différente de capital qui ne produit pas de moyens de production, mais domine la production.
J’aurais pu appeler ce système le « capitalism cloud », et cela n’aurait pas été faux, mais je pense qu’il faut concentrer nos esprits sur le fait que cette organisation est très radicalement différente. Au début du XIXe siècle, il aurait été juste de parler de « féodalisme industriel » ou de « féodalisme de marché », mais en inventant le terme « capitalisme », on a pris conscience du caractère nouveau de ce qui se mettait en place.
N’y a-t-il réellement plus de marché dans le techno-féodalisme ? Plusieurs acteurs semblent pourtant mener une compétition pour se partager leurs marchés.
Ce n’est pas de la concurrence, mais de la rivalité. La rivalité existait entre les seigneurs féodaux. Certains ont disparu, d’autres ont prospéré en absorbant leurs rivaux. Le système féodal n’était pas statique.

Agrandir l’image : Illustration 3© Photo illustration Sébastien Calvet / Mediapart
Dans le cas présent, si on prend par exemple les cas d’Instagram et de TikTok, on constate qu’il n’existe pas de marchés concurrentiels. On ne va pas sur l’un parce que l’on est déçu de l’autre. La concurrence, c’est de pouvoir changer de prestataire sans aucun coût. Ici, il existe un coût non monétaire. J’ai un million d’abonnés sur Twitter et une centaine sur Bluesky : l’existence de Bluesky ne permet pas d’offrir une alternative à l’usage de Twitter. Il est certes possible de s’échapper de cette emprise à titre personnel, mais la logique globale est celle de la capture.
Vous estimez que la rente a remplacé le profit comme moteur du système, mais comme les grandes entreprises technologiques continuent à dépendre de la production capitaliste classique, la production de valeur, et donc le profit, ne reste-t-elle pas centrale ?
Le profit n’a évidemment pas disparu. Il est simplement désormais dominé par la rente. Mais il ne fait aucun doute que la production de plus-value reste un élément important du système. Il faut cependant ajouter à cela une nouveauté, le « travail gratuit » réalisé par les utilisateurs des plateformes qui viennent alimenter les algorithmes, qui ne produit pas de valeur en tant que telle, mais que les techno-capitalistes utilisent pour améliorer leurs algorithmes et capter davantage de plus-value via la rente.
Cela signifie-t-il néanmoins que les contradictions propres à la production de valeur dans le capitalisme restent d’actualité dans le techno-féodalisme ?
Oui, mais parce que ces contradictions sont propres au capital, qui est à la fois une marchandise et une relation sociale, pas au capitalisme. Dans le cadre techno-féodal, cette contradiction non seulement persiste, mais elle est encore plus prévalente.
Dès lors, la croissance devient-elle une nécessité pour le techno-féodalisme ?
Le techno-féodalisme a effectivement besoin de la croissance du secteur capitaliste traditionnel pour maintenir le versement de la rente au « capital cloud ». C’est en cela que ce système est beaucoup plus instable que le capitalisme classique.
La dépendance du techno-féodalisme au secteur capitaliste classique n’induit-elle pas une remise en cause de l’idée qu’il s’agit là d’un nouveau mode de production ?
Non, parce que, par exemple, le capitalisme a longtemps coexisté avec un secteur féodal persistant que l’on retrouve dans les rentes financières ou immobilières. De la même façon, les techno-féodaux ont besoin du secteur capitaliste, mais le dominent. Ce sont eux qui sont au centre du système.

Commentaire