De plus en plus de Français d’origine algérienne partent au pays de leurs aînés pour y établir une entreprise. Beaucoup sont déçus par cette «Algérie idéalisée».
On l'a vu s'introduire dans une réception de l'Élysée pour interpeller Emmanuel Macron. Ou apporter le petit-déjeuner àYacine Oualid, le ministre algérien des Start-ups. En faisant défiler son fil LinkedIn, on comprend que Raibed Tahri est ce qu'on appelle un «influenceur-entrepreneur». En d'autres termes, il documente son quotidien de chef d'entreprise dans le moindre détail comme une influenceuse sur Instagram filme sa routine beauté du matin.
À 39 ans, après avoir réussi en France dans la «foodtech» – il a créé avec Fatiha, son épouse, Pap et Pille, une entreprise de fabrication de biscuits miniaturisés sous forme de billes – ce Français né à Pontarlier (Doubs) a choisi de s'expatrier en Algérie pour lancer de nouveaux projets. «Un jour, j'ai demandé à mon père, Algérien de 88 ans, qui s'est beaucoup sacrifié pour ses enfants : comment faire pour que tu sois fier de moi ? Il m'a répondu qu'il aurait aimé créer quelque chose en Algérie.» Alors qu'il était toujours parti dans son pays d'origine en tant que touriste, en décembre 2023, il s'y rend pour rencontrer des entrepreneurs. Depuis, le consultant en stratégie marketing y a lancé Creator Studio, qui propose des studios d'enregistrement aménagés dans un bâtiment pour les créateurs de contenu. Il travaille sur un concept d'émission – une Star Academy pour entrepreneurs – et, en 48 heures, il a levé plus de 45 millions de dinars (environ 300 000 euros).
«Ceux qui se sont engagés à me suivre sont essentiellement des Algériens de la diaspora, explique-t-il. Ils disaient vouloir investir depuis longtemps mais avaient peur, parce qu'en France, on a une image faussée de l'Algérie.» Dans les milieux d'affaires, il est vrai que le pays est associé à une corruption endémique, une bureaucratie plombante, un climat des affaires hostile…
Nouvel eldorado pour les affaires
Raibed Tahri, lui, assure être arrivé à un «time to market» (dans le jargon commercial, le bon moment et le bon endroit pour le lancement d'un produit). «Entre les aides aux start-up et la création du statut d'autoentrepreneur, le climat est propice au business», assure celui qui a aussi coécrit avec son épouse un livre sur leur «success story» intitulé On lâche rien. Le discours et les mesures (aide au logement, aide à l'investissement) du président Abdelmadjid Tebboune pour inciter la diaspora, nouvelle poule aux œufs d'or, à investir en Algérie, y sont sans doute pour beaucoup.
L'Algérie serait-elle devenue un eldorado pour la diaspora algérienne et les Français d’origine algérienne désireux d’investir dans le pays de leurs aînés ? Sofiane Lesage en est persuadé. Après un parcours universitaire en langues étrangères appliquées et droit, une grande école de commerce, ce brillant trentenaire a «découvert l'univers du voyage» avec son sac à dos, en visitant une cinquantaine de pays. Là, quelque chose l'interpelle. Il trouve incroyable la facilité avec laquelle il est possible de passer d'un pays à un autre en Asie du sud-est alors qu'il est si difficile d'aller en Algérie, «sans doute un des plus beaux pays de la Méditerranée». Avec un autre Franco-Algérien, ils fondent Riwaya Travel, première agence écoresponsable de voyages en Algérie. Comme Raibed, Sofiane trouve dans la diaspora algérienne et dans la communauté franco-algérienne un levier en or pour propulser son business. «On en a pris conscience un soir de juillet 2018, sur les Champs-Élysées, au milieu de centaines d'Algériens venus fêter la victoire de l'Algérie en finale de coupe d'Afrique, raconte-t-il. C’est à eux qu’on a pensé: le maçon à Tourcoing ou le médecin à Saint-Étienne, qui montrent les paysages de leur enfance pendant leur pause déjeuner.
Fuir le wokisme et l’éducation non genrée
À Staouéli, petite ville côtière à l'ouest d'Alger, Lamia Boudoudou gère une maison d'hôtes. Cet été, elle a compté parmi ses résidents un autre profil de Franco-algériens venus «en repérage». «Ils aimeraient élever leurs enfants dans l'islam. Ils disent qu'ils n'en peuvent plus du wokisme ou d'éducation non genrée et cherchent un cadre plus conforme à leurs valeurs», relève-t-elle.
La hijra – émigration pour vivre en terre d'islam – n'est pas un phénomène nouveau. Mustapha, 45 ans, est arrivé il y a dix ans en Algérie, encouragé par un imam et des vidéos d'Algériens ayant déjà fait ce choix, séduit par la proximité des mosquées, ou encore l'absence de programmes «gênants» à la télévision (comprendre : avec des scènes de sexe). «La différence, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui choisissent de faire leur hijra veulent fuir un climat de plus en plus islamophobe en Europe», remarque-t-il.
Céline a fait le voyage en Algérie cet été avec son mari, Tareq, pour étudier la faisabilité d'une installation. Ils vivent avec trois enfants en bas âge à Clermont Ferrand et trouvent que l'air est devenu un peu «irrespirable» dans cette ville de 140 000 habitants. «Je ne porte pas le voile, juste un turban, mais je sens dans le regard des gens que c'est déjà trop. Je ne veux plus vivre comme ça et je ne veux pas que mes enfants aillent dans une école où on va les traiter de sales arabes, confie-t-elle. Parce qu'il faut le dire, les gens sont de plus en plus décomplexés.» Elle en veut pour preuve «la vague de réactions haineuses» qui a frappé Karim Benzema quand l'ex-international français, Ballon d'or, a choisi de rejoindre al-Ittihad, le club de football saoudien, en disant avoir «envie de vivre en terre d'islam».
Briser le plafond de verre
Raibed, lui, aime la France, il ne «crachera jamais dessus» assure-t-il. Son retour en Algérie est le résultat d'une «motivation personnelle», non pas «une échappatoire». Mais, poursuit-il, «en France, je ne pouvais plus évoluer.»
«Tout le monde me parlait d'un plafond de verre. Je pensais que je l’avais brisé. Et puis j'ai voulu lancer une émission télé sur l'entrepreneuriat. J'ai galéré pendant deux ans alors que monter ce projet m'a pris six mois en Algérie,» raconte-t-il. Là où en France, «tout est saturé», l'Algérie est «une terre d'opportunités extraordinaire», affirment en chœur les jeunes patrons. «Tu peux réussir avec peu de moyens et beaucoup d'énergie. En France, c'est le contraire», insiste Raibed, dont «le mindset (l’état d’esprit, NDLR), créer de la richesse en Algérie, est bien défini».
Lamia Boudoudou a fait le même choix, il y a vingt ans de cela. Elle partage le même avis. «En France, on te met facilement dans une case et tu ne peux pas en sortir. En Algérie, j'ai travaillé dans la communication, l'immobilier, la restauration, le tourisme. Peu importe ce que tu fais, la règle c'est : bosse et tu deviendras crédible.» Elle nuance tout de même. «En Algérie, au début des années 2000, je crois qu'il était plus facile de faire des affaires. On voit bien la différence notamment dans le secteur de la communication: aujourd'hui, il n'y a pas autant d'argent qu'avant.»
Dans un pays où le proverbe roi est «pour vivre heureux, vivons cachés», l'hypercommunication de ces ambitieux entrepreneurs sur les réseaux sociaux laisse les Algériens un peu sceptiques. «On en a vu tellement être dans le bling-bling et d'un coup partir avec perte et fracas… il faut montrer que tu apportes de la valeur ajoutée au pays, sinon tu ne pourras pas monter une affaire pérenne, préfère prévenir Mounia, arrivée de Marseille en 2002. Quand tu essaies de profiter de l'Algérie, ça ne marche jamais. Regarde ce qu'est devenu Zéribi…» Karim Zéribi, ex-député européen frappé d'inéligibilité en France, a créé cette année le Congrès mondial de la diaspora. «En se greffant au discours pro diaspora de Tebboune pour faire du fric», se murmure-t-il à Alger. Après un lancement très médiatisé en France, il a subitement disparu et son congrès prévu en Algérie a été tout aussi subitement annulé.
«Algérie idéalisée»
Dans le petit cercle des Franco-Algériens arrivés dans le pays pendant cette «période faste», quand le cours du pétrole faisait couler l'argent à flots, on s'amuse de cette «Algérie idéalisée». Récemment, ils se sont partagé la vidéo de Mansour Kara, cardiologue à l'hôpital Georges Pompidou à Paris, aussi engagé dans la clinique de son père à Oran. «Je ne connais pas un Algérien à l'étranger ou ici (en France, NDLR) qui n'ait pas eu envie ou émis le souhait d'un jour revenir (en Algérie) ou qui ne soit revenu. Je suis parti à l'âge de 15 ans pour finir mes études et le retour était une évidence.»
«Cette génération reproduit le mythe du retour des grands-parents, qui étaient partis travailler en France après la Seconde Guerre mondiale avec dans l'idée de revenir en Algérie un jour. Avec leurs économies, ils ont construit des maisons en Algérie, aujourd'hui complètement vides parce qu'ils ne reviendront jamais et que leurs enfants n'en veulent pas, résume cruellement Samir, la cinquantaine, arrivé en 2006. Quand j'entends les Franco-Algériens appeler les Français ’’les blancs'', ça me choque. Ma génération, elle, n'a jamais rejeté la France ni idéalisé l'Algérie. Cette Algérie devenue terre de business et d'islam.»
Mounia, de la même «promotion», fait le même constat. «On dirait qu'ils veulent déconstruire ce qu'ils sont. Comme s'ils avaient été intégrés de force en France. Ils ne disent pas, comme nous, ''Salut mon pote'', mais ''Salut Habibi'', en pensant parler la langue de leur pays. Mais en Algérie, on ne parle pas comme ça, souligne-t-elle. On dirait qu'ils sont dans l'entre-deux. C'est-à-dire nulle part. Ils se cherchent. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'ils sont Français et que pour les Algériens, ils resteront des étrangers.»
Ceux qui déchantent
Céline, elle, en est un peu revenue, de cette Algérie idéalisée. À l'entrée du jardin d'essai du Hama, célèbre jardin botanique d'Alger où l'été, on peut espérer trouver un peu de fraîcheur à l'ombre des ficus bientôt bicentenaires, elle tente de grouper ses enfants pendant qu'elle déplie sa poussette. L'enthousiasme perceptible au téléphone avant son départ s'est depuis heurté au quotidien.
«Comment font les mamans ici avec leurs poussettes ? Il n'y a pas de trottoir, s'exclame-t-elle, mi-dépitée, mi-agacée, déjà épuisée. Dans l'appartement qu'on nous a prêté, il n'y avait pas d'eau quand on est arrivés. On nous a dit que c'était normal, à cause des coupures. On a dû déménager pour aller ailleurs. Avec les enfants, ce n'est pas simple.»
Elle a aussi commencé à glaner des conseils dans son entourage pour savoir dans quelles écoles inscrire ses enfants. Là encore, rien n’a été comme elle se l’était imaginé. «En France, mon dernier faisait de l'éveil musical. À Oran, je n'ai pas encore trouvé…» Déplore la mère de famille. Arrivée en Algérie depuis un mois, elle tente de «rester positive». Les paysages, le soleil, les gens, «que du bonheur» dit-elle. Mais souvent, l'inquiétude la rattrape. «Oran et Béjaïa sont des villes sympathiques. L'autoroute qui les relie l'est beaucoup moins. C'est dangereux de conduire en Algérie…»
«Complexe de l’immigré»
Raibed Tahri a dû gérer un autre problème. «Quand je suis arrivé, j'avais un peu le complexe de l'immigré», confie-t-il avec pudeur. Le «zmigiri», comme on dit en Algérie, est cet Algérien parti ou né en France qui revient pendant les vacances d'été avec aux pieds, des baskets toutes neuves, et dans ses valises, des cadeaux pour la famille, un accent de banlieue à couper au couteau et beaucoup d'euros. «Il y en a tellement qui sont venus, qui ont fait n'importe quoi, ça laisse des traces. Moi, je suis en mode stagiaire, je ne ramène pas ma science.» Il a intégré que la culture est «différente». «En France, je m'incruste à l'Élysée pour parler à Macron. En Algérie, je ne ferais pas la même chose avec Tebboune !»
À Sofiane, qui a grandi entre les HLM en France et l'arrière-pays sétifien (dans l’est algérien), personne ne peut faire la leçon. «La France des cités je la connais, le pouls de l'Algérie profonde, je la connais aussi», lance-t-il. En faisant venir trente Américaines pour un séjour de danse en Algérie, en plein covid, 48 heures avant la fermeture des frontières, un agrément de professionnel obtenu in extremis, il peut se vanter d'avoir réussi à s’imposer. «En France, les gens attendent un retour sur investissement sur 12 à 24 mois. En Algérie, il te faut quatre à cinq ans avant de structurer ton entreprise. À celui qui s'entête, l'Algérie réussit.»
Par Adam Arroudj







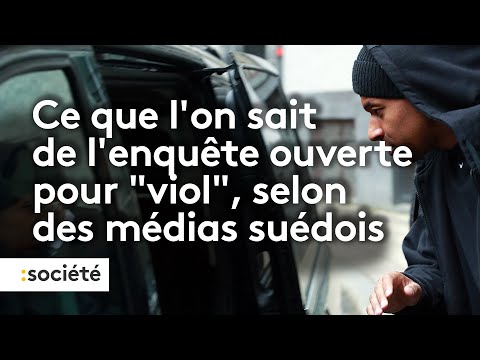
Commentaire