La question posée par une journaliste algérienne au ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, n’était pas un simple exercice professionnel, mais l’expression légitime d’un droit fondamental, celui de poser les questions que l’on juge pertinentes, sans restriction ni intimidation.
En interrogeant le chef de la diplomatie russe sur la présence du corps africain dans certains pays du Sahel et sur les accusations d’exactions portées contre des civils, la journaliste n’a fait qu’exercer, avec compétence, le rôle que tout journaliste digne de ce nom assume, c’est-à-dire chercher la vérité, sans complaisance.
Ce droit élémentaire semble pourtant déranger au-delà des frontières. À peine la question formulée, une partie de la presse marocaine, inféodée au Makhzen, s’est livrée à une attaque virulente contre la journaliste algérienne, usant d’un langage injurieux. Une réaction disproportionnée qui soulève une interrogation simple : en quoi une question professionnelle, posée avec respect et pertinence, peut-elle déranger à ce point ?
Ce déchaînement médiatique en dit long sur l’insécurité et la dépendance d’un système de communication marocain qui ne tolère ni l’indépendance de ton, ni la liberté de questionner.
La réaction du Makhzen et de ses relais médiatiques ne traduit pas une défense de principe, mais une crainte viscérale de la liberté. Ce qu’ils redoutent réellement, ce n’est pas la journaliste algérienne elle-même, mais ce qu’elle incarne : une presse formée, consciente de sa responsabilité, et libre de poser toutes les questions, à tous les interlocuteurs, sans tutelle.
L’Algérie n’a pas besoin d’autorisation pour dire ou demander ce qu’elle estime juste. Et ses journalistes n’ont pas à se justifier d’exercer un métier qu’ils honorent par leur rigueur et leur courage. Poser une question n’est pas un crime : c’est un acte de liberté. Et c’est précisément cette liberté que redoutent ceux qui ont choisi la soumission à la place du professionnalisme.
expressdz
En interrogeant le chef de la diplomatie russe sur la présence du corps africain dans certains pays du Sahel et sur les accusations d’exactions portées contre des civils, la journaliste n’a fait qu’exercer, avec compétence, le rôle que tout journaliste digne de ce nom assume, c’est-à-dire chercher la vérité, sans complaisance.
Ce droit élémentaire semble pourtant déranger au-delà des frontières. À peine la question formulée, une partie de la presse marocaine, inféodée au Makhzen, s’est livrée à une attaque virulente contre la journaliste algérienne, usant d’un langage injurieux. Une réaction disproportionnée qui soulève une interrogation simple : en quoi une question professionnelle, posée avec respect et pertinence, peut-elle déranger à ce point ?
Ce déchaînement médiatique en dit long sur l’insécurité et la dépendance d’un système de communication marocain qui ne tolère ni l’indépendance de ton, ni la liberté de questionner.
La réaction du Makhzen et de ses relais médiatiques ne traduit pas une défense de principe, mais une crainte viscérale de la liberté. Ce qu’ils redoutent réellement, ce n’est pas la journaliste algérienne elle-même, mais ce qu’elle incarne : une presse formée, consciente de sa responsabilité, et libre de poser toutes les questions, à tous les interlocuteurs, sans tutelle.
L’Algérie n’a pas besoin d’autorisation pour dire ou demander ce qu’elle estime juste. Et ses journalistes n’ont pas à se justifier d’exercer un métier qu’ils honorent par leur rigueur et leur courage. Poser une question n’est pas un crime : c’est un acte de liberté. Et c’est précisément cette liberté que redoutent ceux qui ont choisi la soumission à la place du professionnalisme.
expressdz


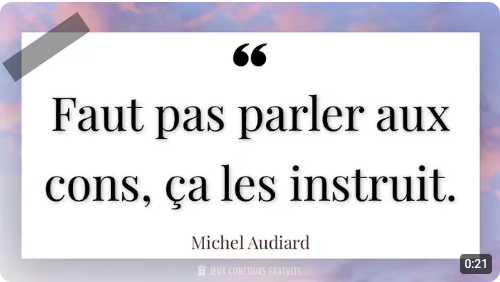
Commentaire